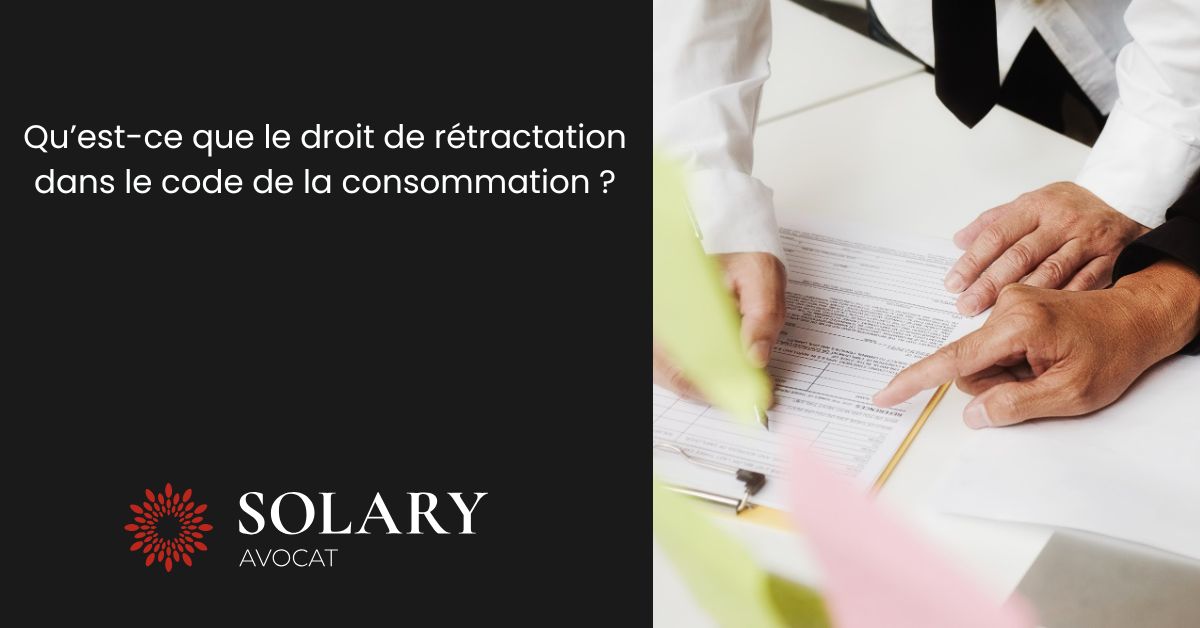Comprendre le greenwashing
Définition et caractéristiques du phénomène
Le terme "greenwashing" provient de la contraction des mots anglais "green" (vert) et "whitewashing" (blanchiment ou dissimulation). Traduit par "écoblanchiment" en français, ce concept désigne l'ensemble des pratiques par lesquelles une entreprise construit abusivement une image de respect des pratiques écologiques. Autrement dit, c’est une stratégie marketing et de communication qui consiste à se donner une apparence vertueuse de façade sur le plan environnemental.
Parmi les caractéristiques du greenwashing, on retrouve l'utilisation d'un langage volontairement vague et imprécis. Des termes comme "naturel", "éco-responsable", "vert" ou "durable" fleurissent sans qu'aucune définition ni preuve ne vienne étayer ces affirmations.
De même, visuellement parlant, le greenwashing convoque bien souvent une imagerie de forêts, feuilles ou animaux avec une charte graphique où les nuances de vert dominent afin de susciter une association mentale entre le produit et la protection de l'environnement.
Le greenwashing peut aussi passer par la mise en avant disproportionnée d'un petit geste environnemental pour masquer un impact global négatif. Par exemple, une entreprise pétrolière qui communique beaucoup sur un léger investissement dans les énergies renouvelables, tout en continuant à extraire des hydrocarbures à grande échelle.
Critères pour repérer une initiative sincère
Premièrement, une entreprise véritablement engagée partage des informations précises, chiffrées et vérifiables : empreinte carbone, consommations d'eau et d'énergie, déchets. Elle est aussi bien transparente sur ses réussites que sur ses difficultés.
Ensuite, il y a les certifications et labels reconnus car délivrés par des organismes indépendants tels que :
- Ecocert ;
Il en existe d’autres mais tous établissent des cahiers des charges exigeants avec des audits réguliers. De ce fait, une entreprise qui se soumet volontairement à ces contrôles externes démontre une volonté réelle de respecter des standards environnementaux.
Par ailleurs, une entreprise sincère intègre les préoccupations environnementales à tous les niveaux :
- conception ;
- matières premières ;
- fabrication ;
- transport ;
- distribution ;
- fin de vie.
Enfin, le ratio entre les sommes dépensées en publicité verte et celles allouées aux investissements environnementaux effectifs en dit également long sur les véritables priorités d’une entreprise.
Les mécanismes du greenwashing
Pratiques commerciales trompeuses
La première stratégie consiste à exploiter la confiance spontanée des consommateurs et la difficulté à vérifier des allégations aussi génériques que "respectueux de la planète", "écologique" ou "bon pour l'environnement". Dans la même veine, il n’est pas rare que des entreprises peu scrupuleuses recourent à des faux labels et certifications maison en créant des logos qui ressemblent à de véritables certifications :
- forme circulaire ;
- couleur verte ;
- mention de la nature.
Tout ceci dans le but de faire croire à une validation externe au consommateur pressé ou non averti, qui va alors accorder sa confiance à la marque.
Le secteur de l’énergie offre une illustration concrète de ces pratiques trompeuses. De nombreux fournisseurs communiquent aujourd’hui sur des offres dites “vertes”, censées reposer sur de l’électricité issue de sources renouvelables. En réalité, cette promesse s’appuie souvent sur le mécanisme des garanties d’origine, qui certifie seulement qu’une quantité équivalente d’électricité renouvelable a été injectée quelque part sur le réseau européen.
Autrement dit, un fournisseur peut acheter ces garanties sans produire lui-même d’énergie verte ni modifier la composition réelle de l’électricité fournie à ses clients.
Lorsque cette distinction n’est pas clairement expliquée, le consommateur est conduit à croire qu’il consomme directement de l’énergie renouvelable — ce qui relève d’une communication potentiellement trompeuse. Le dispositif en lui-même n’est pas frauduleux ; c’est l’usage marketing qui en est fait qui peut prêter à confusion et franchir la limite du greenwashing.
Une seconde technique très répandue est celle dite du "transfert d'image" : une entreprise sponsorise des événements écologiques ou finance des projets de reforestation, tout en continuant des activités polluantes. Ces actions génèrent une image positive qui rejaillit sur l'ensemble de la marque, malgré un bilan environnemental effectif négatif.
Toujours pour détourner l’attention, le greenwashing passe aussi par la mise en scène de faux débats. L’idée est ici de parler d’une problématique mineure (donc peu coûteuse à traiter) pour ne pas parler de problèmes plus conséquents. On pourrait par exemple imaginer une marque de fast-fashion qui communiquerait sur l'utilisation de cintres recyclables, occultant ainsi la question de la surconsommation textile et des conditions de production.
Autre possibilité exploitée par le greenwashing : présenter des données trompeuses ou sorties de leur contexte, notamment des graphiques tronqués ou des comparaisons biaisées. Par exemple, afficher fièrement une réduction significative de ses émissions de CO2, en omettant de préciser que cette baisse concerne un seul site ou qu'elle résulte d'une délocalisation de la pollution.
Enfin, la stratégie du "packaging vert", à l’instar des faux labels, joue sur les codes visuels pour prétendre un engagement environnemental : utilisation du vert, de motifs végétaux, de textures évoquant le naturel, etc.

Rôle des ONG et des autorités de régulation
Les ONG environnementales constituent la première ligne de défense. Des associations comme Greenpeace, Les Amis de la Terre ou WWF France publient régulièrement des rapports dénonçant les cas flagrants, créant ainsi une pression médiatique et réputationnelle sur les entreprises concernées.
Ensuite, des associations de consommateurs comme UFC-Que Choisir analysent les produits et les communications commerciales pour mettre au jour les pratiques trompeuses. Elles informent les consommateurs, les accompagnent dans leurs réclamations et peuvent engager des actions collectives contre les entreprises fautives.
Du côté des pouvoirs publics, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) représente l'autorité administrative chargée de contrôler les pratiques commerciales. Elle dispose de pouvoirs d'enquête importants : contrôles inopinés, exigence de communication de documents et sanctions contre les entreprises coupables de pratiques trompeuses.
Quant à l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), elle intervient spécifiquement sur les communications publicitaires. Cet organisme a développé des recommandations précises encadrant les allégations environnementales. Bien que ses avis n'aient pas force de loi, ils orientent les pratiques du secteur et peuvent conduire au retrait de campagnes problématiques.
En lui même, le cadre législatif français s'est considérablement renforcé :
- La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a introduit de nouvelles obligations, notamment l'interdiction des allégations de neutralité carbone sans justification contrôlable.
- La loi AGEC du 10 février 2020 a durci les règles concernant l'affichage environnemental et les logos trompeurs, renforçant ainsi le droit de la consommation.
Au niveau européen, la Commission a proposé le 22 mars 2023 une directive visant spécifiquement le greenwashing. Entré en vigueur en mars 2024, ce texte interdit notamment les allégations environnementales non prouvées et encadre strictement les labels écologiques.
L’impact du greenwashing
Conséquences sur la confiance des consommateurs
D’abord, il y a l'impact psychologique car les consommateurs soucieux de l'environnement investissent du temps et de l'énergie pour choisir les produits les plus respectueux de la planète. Découvrir qu'ils ont été manipulés génère un sentiment de frustration et d'impuissance.
Bien entendu, ceci érode la confiance. Lorsqu'un consommateur découvre qu'il a été trompé par des allégations environnementales mensongères, c'est l'ensemble des discours écologiques des entreprises qui devient suspect, ce qui pénalise les entreprises véritablement engagées.
Par suite, ce climat de méfiance décourage les comportements de consommation responsable, certains consommateurs renonçant à prendre en compte les critères environnementaux dans leurs choix. Cette démobilisation représente un frein considérable à la transition énergétique et écologique.
Au-delà des consommateurs individuels, le greenwashing affecte les investisseurs et les acteurs financiers : les fonds d'investissement ESG (Environnement, Social, Gouvernance) intègrent également des critères écologiques dans leurs décisions. Or, le greenwashing fausse cette analyse en donnant une image trompeuse de la performance environnementale des entreprises, orientant les capitaux vers des acteurs qui trichent.

Chez Solary Avocat, nous pouvons vous accompagner dans l'analyse de votre situation et la contestation de vos factures et contrat si votre fournisseur n'a pas respecté ses obligations.
Risques juridiques pour les entreprises
Le greenwashing peut être qualifié de ️pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation. L'article L. 121-2 sanctionne en effet les pratiques qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les amendes administratives, imposées par la DGCCRF, peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel moyen ou 50% des dépenses engagées pour la publicité constituant cette pratique.
Il y a aussi un risque pénal : les pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen ou à 80% des dépenses consacrées à la publicité dans certains cas prévus par la loi. Les dirigeants peuvent être personnellement poursuivis, renforçant les risques individuels.
Pour ce qui est des actions en responsabilité civile, les consommateurs trompés peuvent engager des procédures pour obtenir réparation via les actions collectives déjà évoquées.
À moyen terme, le risque réputationnel représente peut-être le danger le plus important. En effet, à l'ère des réseaux sociaux, une accusation de greenwashing peut se propager très rapidement. L’entreprise épinglée voit sa crédibilité durablement entachée et les consommateurs déçus se tournent vers la concurrence.
À noter que si l’entreprise est cotée en bourse, un scandale de greenwashing risque d’être perçu comme une mauvaise gouvernance et donc être sévèrement sanctionné par les investisseurs, ce qui se manifeste par une chute du cours de son action.
Lutter contre le greenwashing
Outils et recommandations pour une communication transparente
La première recommandation consiste à privilégier la précision et la mesurabilité. Plutôt que des formulations vagues, une communication transparente indique des objectifs chiffrés et datés, par exemple : "nous nous engageons à réduire nos émissions de CO2 de X% d'ici 2030 par rapport à 2020". Cette précision permet de suivre les progrès et de vérifier la sincérité des engagements.
Dans un second temps, une entreprise responsable fait valider ses pratiques par des organismes reconnus qui réalisent des audits réguliers, garantissant le respect de critères objectifs et vérifiables.
La transparence implique aussi de communiquer sur l'ensemble du cycle de vie des produits, pas uniquement sur les aspects favorables. Une entreprise crédible reconnaît les limites de son action et les défis qui persistent. Cette honnêteté renforce la confiance.
La publication de rapports RSE détaillés et vérifiés constitue une autre bonne pratique. Ces documents doivent présenter de manière exhaustive :
- les impacts environnementaux ;
- les objectifs ;
- les actions ;
- les résultats.
Parallèlement, l'investissement dans les messages publicitaires doit rester cohérent avec l'ampleur réelle des actions menées. Une petite initiative ne justifie pas à elle seule une campagne de communication.
Enfin, il est important d’utiliser un langage pédagogique et accessible car les consommateurs doivent pouvoir comprendre facilement ce que l'entreprise fait concrètement. Il faut informer et non impressionner.

Exemples d'entreprises respectueuses de l'environnement
Patagonia est un exemple souvent cité d'entreprise véritablement engagée. Cette marque de vêtements outdoor utilise des matériaux recyclés ou biologiques et encourage ses clients à réparer leurs vêtements plutôt qu'à en acheter de nouveaux. L'entreprise, membre historique du programme 1% for the Planet, a transféré en 2022 la propriété de l'entreprise à des entités à but non lucratif (Patagonia Purpose Trust et Holdfast Collective) pour garantir la pérennité de ses engagements environnementaux.
Dans le secteur alimentaire, Bio c'Bon ou Biocoop ont construit leur modèle autour de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Ces enseignes s'engagent sur l'ensemble de la chaîne, privilégient les circuits courts et communiquent aussi bien sur leurs réussites que sur les difficultés rencontrées.
Veja, marque française de baskets, utilise du caoutchouc naturel provenant d'Amazonie dans le cadre d'un commerce équitable avec des coopératives locales, du coton biologique et des matériaux recyclés. Elle publie régulièrement des rapports détaillés sans cacher les défis. Cette authenticité lui a permis un succès commercial tout en maintenant ses exigences environnementales.
Enfin, Interface, spécialisée dans les dalles de moquette, a entrepris dès 1994 une transformation radicale de son modèle de production avec le lancement de Mission Zero. L'entreprise s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre un impact environnemental nul d'ici 2020, objectif atteint ou dépassé sur plusieurs indicateurs clés. Elle partage ouvertement sa démarche, ses succès comme ses échecs, inspirant ainsi d'autres acteurs industriels.
En résumé, le greenwashing constitue une pratique déloyale qui exploite les préoccupations environnementales légitimes des consommateurs à des fins purement commerciales.
En tant que consommateur, vous disposez de droits concrets pour vous défendre face aux allégations environnementales mensongères. La vigilance reste votre meilleure alliée : questionnez les discours trop vagues, vérifiez les certifications, exigez des preuves.
Solary Avocat peut vous accompagner que vous soyez consommateur victime de pratiques trompeuses ou entreprise soucieuse de respecter le cadre légal. Contactez-nous !
Points-clés sur le greenwashing
Comment savoir si une entreprise fait du greenwashing ?
Plusieurs signes permettent d'identifier le greenwashing : des allégations environnementales floues sans données précises, l'absence de preuves ou de certifications reconnues, une communication verte disproportionnée par rapport aux pratiques réelles de l'entreprise ou encore l'utilisation de visuels évoquant la nature sans lien avec le produit. Méfiez-vous également des labels créés par l'entreprise elle-même plutôt que par des organismes indépendants.
Puis-je porter plainte contre une entreprise qui fait du greenwashing ?
Vous pouvez agir à plusieurs niveaux contre le greenwashing. D'abord, signalez la pratique à la DGCCRF via le site SignalConso, qui peut mener des contrôles et sanctionner l'entreprise. Vous pouvez également saisir l'ARPP si la publicité vous semble trompeuse. En cas de préjudice direct, vous avez la possibilité d'engager une action en justice pour pratique commerciale trompeuse, notamment si vous avez acheté un produit en vous basant sur des allégations environnementales fausses. Un avocat en droit de la consommation pourra vous conseiller sur la meilleure stratégie et vous accompagner dans vos démarches pour obtenir réparation.
Le greenwashing concerne-t-il uniquement les grandes entreprises ?
Non, le greenwashing touche des entreprises de toutes tailles. Si les grands groupes disposent de budgets marketing importants qui rendent leurs campagnes plus visibles, les petites et moyennes entreprises peuvent aussi recourir à ces pratiques trompeuses. Parfois, une PME locale peut utiliser des formulations vagues ou créer son propre label écologique sans réelle substance. L'échelle diffère, mais le principe reste identique : faire croire à un engagement environnemental qui n'existe pas ou est exagéré.

En tant qu'avocat, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux de vos intérêts.